Fiche de lecture - Ralentir ou périr de Timothée Parrique - Version Longue
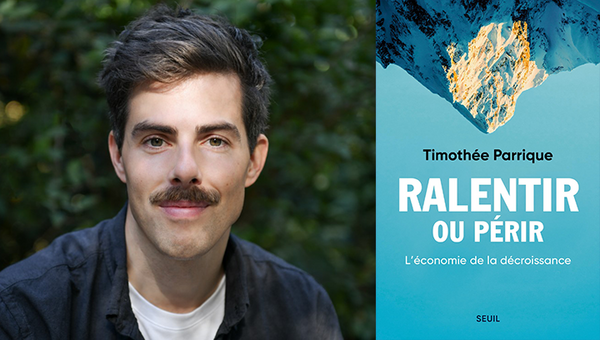
Cette fiche est une synthèse de chaque chapitre du livre. Elle reprend les phrases qui m’ont semblé être les plus capitales, celle qui résument le mieux les différentes idées du livre.
Il n’y a aucune interprétation. On peut donc s’en servir pour faire référence au bouquin directement.
Introduction
On est actuellement dans l’Anthropocéne, période de l’histoire qui coïncide avec l’accélération des activité humaines et l’usage intensifs des ressources basées sur la carbone.
En 2021, les 10% des ménages les plus riches du monde possèdent 76% du patrimoine global, plus de la moitié de tous les revenus et 6 fois plus de revenus que 50% des plus pauvres de l’humanité. En France les 10% des plus riches possèdent la moitié du patrimoine national et capte un tiers de tous les revenus.
Ces mêmes 10% sont responsables de la moitié des émissions des gaz a effet de serre. En résumé, les riches polluent et les pauvres subissent. Double injustice.
C’est donc plutôt un Capitalocène qu’un Anthropocène. L’économie est devenue une arme de destruction massive.
Pour autant, l’économie s’impose a nous qu’on le veuille ou nous a travers les règles qu’il nous faut respecter : des prix, un contrat de travail, un prêt immobilier, les règles comptables. Ce qui n’est pas un mal en soi.
Le principal problème est l’objectif qui l’anime : la croissance.
Indicateur né dans les années 30 avec comme objectif de relancer l’économie américaine après la grande dépression, il est devenu, avec le PIB, un objectif en soi et un compte à rebours de fin du monde : 2% de taux de croissance faire doubler la taille de l’économie tous les 35 ans !
Le défi est donc de faire moins, plus lentement, plus social et avec une empreinte écologique acceptable et pour cela se libérer du mythe de la croissance pour imaginer une décroissance, transition vers une économie post-croissance.
Le PIB
Définir la croissance comme hausse du PIB revient a décrire la chaleur comme une hausse de température. C’est une description sans explication.
La description actuelle de l’économie comme ‘sphère de l’échange marchant’ ne capture qu’une infime partie de nos vies. Le PIB mesure l’économie que l’on sait quantifier et en exclut par exemple les services écosytémiques, l’entraide, le bénévolat, etc. par convention méthodologique.
Cette définition empêche de voir l’économie sous d’autres angles aussi Timothé propose une définition plus méta : “l’organisation sociale de la satisfaction des besoins”.
Il considère l’argent comme une forme intermédiaire de la valeur produite : l’économie est avant tout une histoire de temps, d’effort/énergie et de matière.
Il y a 5 grandes familles d’activités économiques : l’extraction (mobiliser les ressources naturelles), la production (transformer cette ressource pour obtenir un produit), l’allocation (transférer ce bien, le donner, le prêter, le répartir ou le vendre), la consommation (utiliser de manière individuelle ou collective - c’est le stade de la satisfaction du besoin) et l’élimination(se débarasser des déchets).
L’économie n’est qu’un moyen et non une fin en soit. La finalité, si il y en a une, devrait être de faire progresser les capabilités d’épanouissement et améliorer la qualité de vie, de l’existence. Une économie qui ne satisfait pas les besoin de ses participants est donc inutile : A quoi bon s’organiser collectivement si cela n’améliore pas la qualité de vie ?
L’économiste Max-Neef répertorie 9 types de besoins : la subsistance, la protection, l’affection, la compréhension, la participation, le loisir, la création, l’identité et la liberté.
Selon l’économiste Amartyra Sen, la pauvreté n’est pas le manque d’argent mais l’incapacité a satisfaire un besoin. Le bien-être découle de notre capacité a faire. La pauvreté est donc multiple. La richesse aussi est donc multiple.
Une meilleure définition de l’économie pourrait donc être ‘l’organisation sociale de la satieté des besoins’.
L’économie est donc un système d’approvisionnement qui permet de contenter des besoins.
Ce cycle se déroule sur 3 horizons temporels :
le bien-être présent, a l’opposé cette économie est inutile
la résilience de ce bien être face aux chocs, a l’opposé cette économie est fragile
la soutenabilité de ce système sur le long terme, à l’opposé cette économie est insoutenable.
Toutes les formes d’économies actuelles ou passées fonctionnent avec ce méta modèle.
Histoire du PIB
Les Etats-Unis ont inventé le PIB dans les années 1930 au moment de la Grande Depression. Le but était d’avoir une sorte de tensiomètre pour prendre le pouls de l’économie dans son ensemble. Si ca monte c’est positif, si ça ne bouge pas, les mesures ne sont pas efficaces.
Cet outil a continué d’être utilisé après la crise des années 30.
Sa définition officielle est ‘ la somme des valeurs ajoutées brutes de toutes unités institutionnelles résidente qui exercent des activités de production’.
Il fait donc une gigantesque addition de toutes les valeurs ajoutées des productions considérées comme économiques.
Il ne prends pas en compte la dépréciation du capital, c’est un indicateur Brut. C’est une différence négligeable si, comme actuellement le PIB le fait, à certains facteurs de production comme les routes, les réseaux électriques, les bâtiments etc.
Si on élargit le concept de capital à la nature, à la santé et au bien-être des travailleurs, la différence devient non négligeable si l’on intègre la dégradation des écosystèmes et des individus.
C’est la limite de cette mesure : se réjouir d’une hausse du PIB sans connaitre la façon dont il est calculé revient à se réjouir de voir son réfrigérateur se remplir sans savoir de quoi.
Les frontières du PIB
L’objectif d’augmenter la croissance devrait spécifier la nature et la finalité de cette croissance.
On l’a vu, le PIB n’est qu’une estimation sélective et approximative de certaines valeurs.
Il y a plusieurs limites au PIB.
Il ne mesure que les valeurs d’échange mais pas les valeurs d’usage. Cela exclu tout ce qui n’a pas de prix, par exemple l’accès libre a ce livre, les activités bénévoles (qui représente 20 millions de personnes en France).
La production de la sphère publique est fortement sous-estimée car seuls les couts des services publics sont inclus dans le PIB (les salaires) sans prendre en compte leur valeur ajoutée réelle. A cause de cela, le même service contribue d’avantage au PIB s’il s’agit d’un service privé (les prestations sont facturées) que s’il s’agit d’un service public.
Il n’y a qu’un touche ‘+’ au PIB, on ne fait pas de différence entre ce qui est désirable et ce qui est néfaste. Aussi une augmentation du PIB n’est pas forcément une bonne nouvelle ne cachant rien de la nature positive ou négative des biens et services produits.
Enfin, le PIB fait abstraction de la nature.
Les ressource naturelles n’ont de valeurs qu’extraites et vendues, mais la production par la biosphère elle-même et les services qu’elle rends ne compte pas. Ni sa destruction.
Selon l’économiste Eloi Laurent “le PIB est borgne quant au bien-être économique, aveugle au bien-être humain, sourd à la souffrance sociale et muet sur l’état de la planète”.
La croissance, une question de taille et de vitesse
Le PIB ne mesure pas un stock de richesse mais un flux de production de richesse sur une période donnée.
Ce qu’on appelle la croissance est plus proche d’une intensification de l’agitation économique qu’une augmentation de la richesse totale.
On décrit 2 types de croissance : l’une basée sur l’expansion du périmètre de l’économie marchande et l’autre basée sur l’intensification des types de transaction déjà existantes.
Expansion signifie qu’on transforme quelquechose qui se trouvait en dehors de la sphère monétaire en un produit qui peut être vendu (passer d’une pêche pour soi, à sa marchandisation, passer du prêt d’appartement entre individu à AirBnb).
Intensification signifie faire tourner plus vite l’économie déjà existante (changer de tel tous les 2 ans au lieu de tous les 10 ans), ce qui accelère la production pour le même marché.
Cette sphère peut aussi rétrécir si ces produits et des services sortent de la sphère du PIB.
Elle peut aussi ralentir, si on décide de moins acheter, moins consommer et donc moins produire. (exemple lors de la pandémie COVID).
Décomposer le concept de croissance permet démystifier la croyance moderne selon laquelle une croissance du PIB est toujours un progrès et la décroissance forcément indésirable.
Croissance ou décroissance ne nous disent rien de la véritable performance de l’économie. Le rythme effréné actuel de l’économie n’est pas une fatalité mais bien la conséquence de choix sociaux.
Ingrédient de l’activité économique
Toutes les activités économiques pour produire nécessitent des ‘facteurs de production’ comme l’énergie, les matériaux, le travail , les institutions.
Certains sont comptabilisés dans le PIB, certains non.
Le premier qui n’est pas comptabilisé est la nature. Il existe des processus ecosystémiques comme la pollinisation, la régulation du climat, ou encore le cycle de l’eau qui sont des productions écologiques fournies par le vivants sans lesquels il nous serait impossible de vivre. La plupart des économistes pensent que les facteurs de productions écologiques peuvent être substitués par des facteurs de productions humains (outils et travail).
Dans les faits cette hypothèse est fausse car chaque production humaines, même de substitution demandent des ressources et de l’énergie.
Le second est le temps de travail. Toute production nécessite du temps et de l’effort. Cette force de travail dépends de la population active. La population etant limitée, le travail n’est pas un facteur de production sans limite.
Le troisième est les institutions. Difficile de produire sans règles comme la monnaie, un marché pour faciliter les échanges, les protocoles de crédit pour financier les projets, une législation pour garantir les droits de toutes et tous ,etc. La nature développe des écosystèmes, les sociétés des institutions pour fournir les services sans quoi la production devient impossible.
Progrès technique, progrès économique
On confond 2 types de progrès.
Le progrès anthropologique qui permet de mieux satisfaire les besoins avec moins de ressources, il s’agit du progrès économique.
Le progrès ’technique’ qui n’est qu’une illusion de progrès car il fait croire à une meilleure productivité alors qu’il s’agit uniquement d’une transformation de richesse sociale et/ou écologique (réemplois du temps de travail pour autre chose, ou épuisement écologique) en une richesse financière.
Moteurs de la croissance
Les moteurs de croissance sont les mécanismes qui mènent à l’agitation de la sphère marchande.
Il y en a 3.
Les entreprises qui cherchent a maximiser leur profits et minimiser leurs couts.
Les consommateurs, plus on est inciter a consommer, plus les entreprises font des bénéfices.
l’Etat, sous les ambitions des gouvernements, la puissance publique pousse a faciliter la marchandisaiton de certaines sphère sociales en ésperant que la privatisation amènera des points de PIB, réduire les charges des entreprises et favoriser l’investissement des entreprises.
Ideologie de la croissance
l’idéologie de la croissance est cette vision du monde qui applique les cadres de l’analyse économique contemporaine - néoclassique, capitaliste, neoliberal - au réél.
La primauté de l’économie sur tout le reste. L’économie devient une religion.
Un PIB qui augment est considéré comme naturel, inévitable et universel, une mystique de la croissance.
A l’inverse, faire preuve de simplicité volontaire dans une économie organisée autour de la croissance est aussi difficile que de jouer a grand theft auto dans commettre un crime : il est difficile de ne pas penser capitalisme dans un monde qui ne jure que par cet idéologie.
Or cette idéologie de la croissance exponentielle et infinie est une anomalie sociohistorique. La croissance est l’exception et non la règle. C’est une phase qui, une fois terminée, laisse place à d’autre dynamique.
2- L’impossible découplage / les limites écologiques
La question du découplage de l’économie et de l’écologie revient a se poser la question d’un fumeur qui observe qu’il a des problème de santé et à qui on conseille d’arrêter de fumer mais qui préfère continuer et penser qu’à l’avenir on saura dissocier tabagisme et cancer du poumon. Peut-on découpler l’économie sans détruire l’écologie ?
Croissance verte et découplage
Le découplage signifie que l’évolution d’une grandeur cesse d’évoluer proportionnellement à une autre.
Il peut être relatif (la progression de l’un est plus faible que la progression de l’autre mais elles restent proportionnelle) ou absolu (la progression ou la régression de l’un se fait sans rapport avec l’évolution de l’autre).
Il peut être temporaire (limité à une période, et ensuite il y a recouplage) ou permanent.
Le développement durable que l’on nous vends devrait donc être une croissance adossé à un découplage total, absolu, global et permanent.
Une telle croissance verte n’a à ce jour jamais existé.
Le découplage est une fake news
Après vérification de toutes les études existantes sur des découplages, les quelques découplages sont relatifs, temporaires et concerne une minorité de pressions environnementales.
L’un des problèmes majeur est que l’on ne parle que du carbone en oubliants les autres pressions écologiques comme la biodiversité, l’extraction de matériau etc.
Souvent le découplage d’une pression se fait au détriment d’une ou plusieurs autres. L’électrification implique la production d’éolienne, de panneaux solaires ou de barrages, des voitures électriques, etc. tout cela demande une énorme extraction de matériaux et de déforestation par exemple.
Le deuxième problème est qu’on ne comptabilise pas les importations. Or dans les pays les plus riches, les productions émettrices sur le territoire national ont toutes été délocalisées ce qui fait que l’impression d’économie verte et une découplage cache en réalité leur émission dans d’autres pays.
Le troisième problème est que lorsqu’il y a découplage, il n’est que temporaire. Souvent elle n’est le fait que du passage d’une ressource très polluante à une ressource moins polluante, mais polluante quand même et toujours proportionnel a la croissance. Par exemple le passage du charbon au pétrole et au gaz.
Le 4e problème est lorsqu’il y a une baisse des émissions de co2, elle est insuffisante.
Par exemple en France, la réduction des émissions entre 2010 et 2019 a été de 1.7% par an là ou l’objectif européen de réduction des émissions est de 55% en 2030.
Pour limiter le réchauffement à 1.5 degrés il faudrait une réduction de 10 a 13% par an.
C’est le constant en France, c’est pire au niveau mondial.
Enfin le 5e problème est que les émissions en baisse observée concerne des pays dont le taux de croissance est faible, ce qui finalement confirme juste l’existence d’un couplage entre croissance et émissions.
En conclusion, la croissance verte est une légende, elle n’a jamais eu lieu jusqu’a présent.
Découplage improbable
Maintenant est-ce qu’il est probable que ce découplage s’observe un jour ?
Il y a plusieurs limites qui rend cet évènement improbable.
1- l’augmentation des dépenses énergétique. Tout ce que nous produisons demande de l’énergie, et toute énergie demande des matériaux de construction pour la produire. Et il faut un certain temps pour qu’une technologie restitue suffisamment d’énergie pour rembourser celles de sa construction. Actuellement ce ROI énergétique est constamment en baisse passant de 7:1 en 99 a 6:1 en 2018 (incluant énergie carbonée et énergie renouvelable).
Même problème avec la concentration des matériaux qui tende a diminuer ce qui demande plus d’énergie pour produire la même quantité de matériaux.
Il est physiquement impossible d’obtenir une énergie 100% verte à l’infini dans un environnement aux ressources finies.
2- les effets rebonds. Lorsqu’on arrive a améliorer la productivité, plutôt que réduire la consommation, il est constaté qu’il y a une intensification de l’usage. (par exemple lorsque les voitures ont consommé moins d’essence, elle ont été utilisée 2fois plus) ce qui annule le gain de productivité).
Ce qui existe au niveau d’une famille est vrai aussi à l’échelle d’un pays.
D’autres exemples : l’usage des LED a fait exploser son usage, la 5G économe en énergie incite a augmenter le traffic de données, et également au remplacements des équipements.
3- l’empreinte écologique des services.
Un autre espoir du découplage est de remplacer les pans de l’économies industrielle par du tertiaire.
Le problèmes est que cela ne va que si on remplace une économie par une autre. Sauf que ans les pays riches, l’économie tertiaire a deja drastiquement été réduite.
Ce qui fait que l’économie tertiaire vient s’ajouter aux autres et non la remplacer. Sachant que l’économie tertiaire est loins d’être verte contrairement aux idées reçues.
Au mieux on observera un découplage temporaires lorsque la tertiarisation est en cour.
4- les limites du recyclage.
L’idée est que si on recyclait tout les matériaux nécessaires à la production de nouveaux bien à partir de nos déchets, nous arriverons a une économie verte.
Tous les déchets ne peuvent pas être recyclés (les combustibles, la biomasse, etc.) , certains déchets sont trop complexes pour être recyclés (30% au mieux pour le smartphone le plus recyclable actuellement) tout de qui est recyclage n’est pas recyclé en pratique(25% des plastiques recyclé, 35% brulés et 31% enfouis en 2019) et enfin les matériaux ne se recycle pas à l’infini et finisse par être ‘downcyclé’.
5- les freins technologiques.
autre idée : c’est l’innovation qui permettra l’économie verte. En réalité peu d’innovation vertes par rapports aux innovations polluantes. Et il y a une inertie des entreprises à utiliser les innovations vertes (plus couteuses généralement) si elle peuvent user des technologies polluantes.
Il n’y a pas non plus de remplacements des technologies polluantes par des technologies vertes : elles s’empilent comme les sources d’énergie.
Enfin la fréquence d’innovation pour améliorer la productivité permettant de réduire l’impact écologique compte tenu de la progression de la croissance est intenable : il faudrait générer un gain de productivité de 100% tous les 35 ans.
Bref l’hypothèse d’un découplage qui permettrait de verdir le PIB ne tient pas l’étude des chiffres.
Les limites sociales de la croissance (marché contre société)
Tout processus de production repose non seulement sur la nature mais aussi la la nuture. Ce mot désigne notre capacité a prendre soin de nous-même et des autres.
L’augmentation exponentielle de l’activité marchande finit, tôt ou tard, par se heurter à ce que les économiste féministes appellent les capacités reproductives d’une société.
On peut prendre l’exemple d’Adam Smith, célèbre intellectuel, qui n’aurait pas produit tout ses travaux si sa mère n’avait pas pris soin de lui toute sa vie.
En économie féministe, les forces reproductives corresponds a la sphère qui contribue au soin, à l’entretien, au renouvellement, à l’amélioration de notre capacité de production, grosso modo le bon fonctionnement de la vie sociale. On y trouve les taches domestiques, l’entreaide, le bénévolat, etc. Toute cette activité n’est pas prise en compte dans les calculs de production.
Le travail domestique, selon un calcul de 2010, représenterait entre une à deux fois le temps de travail rémunéré, soit entre 1/3 et 2/3 du PIB.
En bref, ceux qui produisent sont eux-même produits.
Représentons les productions comme des cercles concentriques. La sphère de la production marchandage est encastrée dans la sphère plus large de la reproduction sociale, elle même encastrée dans l’économie du vivant/ sphère de la reproduction écologique.
Pour que la sphère de production existe, il faut que la sphère de reproduction sociale existe, et il faut que la sphère de la reproduction écologique existe.
Le budget temps de l’économie
Nous ne travaillerons jamais plus de 24h par jour. Or toute activité de production prennent du temps.
L’économie pourrait dont consister à organiser le partage des ressources finies, comme le temps. Mais on ne pourra jamais s’affranchir de la limite que constitue notre temps.
Le fantasme magique de l’innovation
Est-ce que tout les gains de productivité nous font gagner du temps ?
Généralement les gains de productivité (facteur de production) se font par la sur-sollicitation des facteurs de reproduction (repos, fertilité du sol, pollinisation, etc.).
Les innovations, sont des productions à part entière, est avant de pouvoir appliquer de nouvelles technologies, il faut les inventer. Cela n’est possible qu’en dédiant du temps non productif, donc reproductif à cela.
Le progrés techniue nous fait-il gagner du temps ?
Le philosophe Ivan Illich appelle ‘seuil de contre-productivité’ le seuil au delà duquel une technologie que nous avons inventé pour gagner du temps finit par nous ralentir.
Pour calculer cela, il est nécessaire non pas simplement de comptabiliser notre temps personnel mais le temps collectif que cela a représenté. Par exemple pour construire une voiture qui va personnellement me faire gagner du temps, quel a été le temps dépensé par d’autres pour extraire les matériaux, construire le produit, le vendre, le recycler, et le temps de travail pour maintenir les liens sociaux autour de toutes ces activités et le temps nécessaire a maintenir les infrastructure qui permettent aux voitures de circuler correctement, etc.
Est-ce que la promesse de gagner du temps est-elle toujours tenue ? Pas toujours.
La contradiction de la reproduction sociale
Si je travaille 40h par semaine pour payer mes factures, difficile pour moi de gérer une association, écrire un livre ou organiser une monnaie locale.
Selon David Harvey, la croissance économique se fait souvent via une ‘accumulation par la dépossession’.
Le secteur marchand dépossède le secteur non marchand.
La sphère de la reproduction est fondée sur la logique du contentement : quand c’est suffisant c’est suffisant.
La sphère de la production, au contraire suit une logique d’accumulation. A ressource limitées, les activités accumulatives finissent tôt ou tard par accaparer les ressources des activités stationnaires, et tend a déstabiliser les processus de reproduction sur lesquels ils s’appuient dégradant nos capacités reproductives, et donc finalement la croissance potentielle. Situation du serpent qui se mord la queue.
Triste croissance
Selon Harman Daly et MAnfred MAx-Neef, la prospérité ne serait pas une histoire de croissance infinie (d’accumulation) mais plutôt de taille optimale (suffisance).
La prospérité n’est pas seulement une question de quantité mais aussi de qualité.
Le PIB est en essor mais la société est en berne.
Qu’est-ce que la marchandisation ?
C’est un protocole social avec des règles communes nous permettant de gérer l’allocation de ressources. C’est la transformation de quelquechose en un produit échangeable sur un marché.
En théorie tout peut se marchandiser, en pratique, il y a certaines choses qui sont plus difficile a marchandiser.
La marchandisation entraine aussi la perte d’une valeur qui existait avant.
Corruption des marchandises
Fred Hircsh parle d’un effet de commercialisation : Marchandiser quelquechose peut dégrader la satisfaction que l’on en retire. Cela peut même la corrompre : faire un enfant dans le but de le vendre pour gagner le l’argent par exemple corromps la parentallité.
La chose est la même mais la relation sociale est différente.
La marchandisation comme dissolution du social
Delom Polanyi, il y a certaines choses qui ne devraient pas être traitées comme des marchandises : le travail, la terre et la monnaie.
La prévalence de l’échange marchand comme mode d’allocation réduit la possibilité que se développe les autres modes d’allocations : le dons, la réciprocité et la répartition.
Selon l’Anthropologue David Graeber, ce sont les relations non marchandes qui maintiennent la cohésion d’une société, la marchandisation devient problématique car elle érode ce ciment social.
L’acte de paiement remplace une dette sociale. Marcel Maus écrit aussi que c’est l’impossibilité de rembourser immédiatement et exactement ce que l’on doit qui fait vivre le lien social.
Au contraire, avoir marchander du social justifie des comportements qui auraient autrement été considéré comme socialement inacceptable.
En conclusion, une croissance trop intense du marché viendra agir comme une force de dissolution du social. La croissance est donc insoutenable et aussi parfois indésirable lorsque la marchandisation dégrade, corrompt le social.
Fausses promesses, les limites politiques de la croissance
Qu’en est-il des raisons politiques de la croissance telle que éradiquer la pauvreté, réduire les inégalités, diminuer le chômage, financer les budgets publics ou améliorer notre qualité de vie ?
La pauvreté
Certains dise que croissance rime avec abondance, ce qui réduirait la pauvreté.
Officiellement en France, il y aurait 10 millions de personnes pauvres selon l’INSEE.
Pour subvenir a ses besoin une personne active seule a besoin de 1424 euros, un couple avec 2 enfants 3284 euros.
Selon les calculs de Pierre Concialdi, alors que la balance économique de la France était nulle au lendemain de la seconde guerre mondiale, elle change radicalement a partir des années 60. En 2013 le surplus était de 900 milliards d’euros, chiffre qui varie peu depuis.
Il est donc théoriquement possible que toute la population française vive décemment car la France a assez de richesse pour cela.
Le problème est que cette richesse est mal distribuée : depuis les années 80, 50% des français capte 20% de la croissance totale là où 1% des plus riches capte 50% de la croissance totale.
Il suffirait donc de réallouer la richesse au personne qui en ont besoin pour régler le problème de la pauvreté.
Une autre solution pour éradiquer la pauvreté est de démarchandiser une partie de l’économie. Et la remplacer par des services de base gratuits conne une sécurité alimentaire, un cheque énergie, un pass culture, une allocation universelle d’autonomie, etc.
Cela ne suffit pas car il faut aussi faire en sorte que la valeur ajoutée de la production soit plus équitablement distribuée : les métiers de base sont systématiquement tenus par les plus pauvres et ce sont les plus mal payés.
En somme la pauvreté en France n’est pas pas une question de production : la richesse existe en surabondance, c’est une question d’allocation. Ce n’est pas un acte de générosité, simplement un retour à la raison dans un système qui a oublier d’où provenait la richesse.
Les inégalités
Il y a une théorie des années 80, provenant des travaux de Simon Kuznets, qui suggère qui sur le long terme, la croissance des hauts revenus profiteras aux plus bas revenus par ‘ruissellement’.
Cette hypothèse est fausse, n’a aucune base théorique solide.
Autre point, la croissance du PIB ne nous dit pas si ce sont les salaires ou les revenus du patrimoines qui en sont la cause. Pourtant c’est une information essentielle si l’on veut savoir si la croissance réduit les inégalités (les salaires augmentent plus vite que les revenus du patrimoine) ou au contraire les aggrave.
La croissance d’une économie capitaliste, par défaut, aggrave les inégalités.
En 2018 les 10% des salariés les moins bien payés gagnent moins de 1282e par mois alors que pour faire partie des 10% les mieux payés, il fallait gagner au moins 2,0 fois soit 3776e.
Pire, les inégalités s’autoamplifient. plus les riches s’enrichissent, plus ils peuvent épargner et génerer des revenus. Ce qui laisse de moins en moins de part de richesse aux plus pauvres.
Vu que les inégalités cause du tord a tout le monde, on aurait finalement pu se passer de la croissance depuis les années 80.
Pour réduire les inégalités sans croissance, il suffirait de baisser les part des rentes et d’augmenter les part des salaires. Cela démystifie l’idée qu’il faut absolument de la croissance pour lutter contre les inégalités.
Parmi les solutions possible, on pourrait limiter l’écart des salaires de 1 à 4, on pourrait redistribuer le patrimoine et les revenues en renforçant l’impôt sur la fortune, la fortune immobilière, réformer l’héritage, encadrer la propriété foncière, etc.
Encore une fois, pour réduire les inégalités, rien ne sert de faire croitre l’économie, il faut simplement partager.
L’emploi
Lorsque l’on questionne la croissance, l’une des peur profonde est celle du chômage de masse.
L’objectif du plein emploi est vide de sens s’il n’est pas mis en relation avec les besoin satisfaits au travail.
Prenons donc un autre point de départ : que voulons-nous produire et comment ? Car toute création d’emploi n’est pas désirable s’il n’est pas utile. Il y a même des emplois qui sont contreproductifs : tous les métiers qui impactent et qui vont demander un effort important pour s’adapter au changement climatique par exemple.
Un emploi qui permette de payer les factures n’est pas une condition nécessaire pour dire que nous en avons besoin.
La pauvreté en France est un problème de distribution de la richesse et l’obligation de travailler a temps plein et à vie découle de choix l’organisation économique, celui d’un système capitaliste à gouvernance néolibérale.
Le travail est une activité bien trop centrale pour être marchandisée, la solution à un chômage de masse n’est pas la création d’emploi en masse mais plutôt une réorganisation de la façon dont nous contribuons à l’activité économique.
L’objectif d’une économie est d’économiser les ressources disponibles, à commencer par le labeur du travail. Une économie performante devrait logiquement détruire du temps de travail.
Maximiser le PIB pour créer de l’emploi est donc absurde.
Budget public
Autre crainte : sans croissance, il y aurait moins de recette de taxe et donc cela réduirait le budget de l’état qui ne pourrait pas garantir les services publics.
Le financement des activités publiques n’est pas plus dépendant de la croissance que celui des activités privées.
La dette de l’état n’est pas non plus un drapeau rouge, l’état n’est pas un agent économique comme les autres car il peut faire ‘rouler sa dette’. A chaque fin d’emprunt il rembourse en réalisant un nouvel emprunt, etc.
Qualité de vie
On devrait observer une forte corrélation entre le PIB est le bonheur, mais ce n’est pas le cas en réalité.
La Finlande et le Danemark arrivent en tête des pays heureux avec un PIB bien inférieur à celui d’autres pays bien moins classés.
Selon Richard Wilkinson, si la Grande Bretagne venait à réduire de moitié les inégalité de revenus, le pays pourrait diviser par deux ses taux de criminalités, d’obésité, se débarrasser de 2/3 des maladies mentales et augmenter le niveau de confiance de 85%. Sans croissance du revenu national.
Les besoins fondamentaux suivent des deuils de suffisance, il ne sert dont a rien de traiter la satisfaction des besoins comme quelquechose qui devrait croitre indéfiniment.
Une partie de notre confort dépend aussi de choses qui ne sont pas comptés dans le PIB comme le temps passé au contact de la nature.
Autre chose, selon Thorstein Veble, nous consommons non seulement pour satisfaire non besoin directs mais aussi pour afficher un statut social, pour se distinguer.
Cet effet de démonstration nous pousse à la surconsommation sans fin comme dans une roue pour hamster, qui au final ne contente personne ou peu de monde.
Pour une économie de bien-être, il faut arrêter de parler de niveau de vie quantitatifs et se concentrer sur la qualité de vie.
Les barrières à l’action ne sont pas économiques mais politiques, morales et culturelles.
Petite histoire de la décroissance
L’idée de décroissance est l’aboutissement de plusieurs concepts qui remontent au moins aux années 60. Partant de l’idée d’objection de croissance, le terme évolue vers celui de décroissance et de post-croissance dans les années 2000.
C’est en France que le terme émerge en 2002 et commence à se populariser. En 2008, il passe dans la sphère anglophone sous le terme degrowth.
La préhistoire de la décroissance
Le mot décroissance apparait la première fois le 14 juin 1972 chez André Gorz qui commente les conclusions du rapport Meadows.
La première fois que l’idée selon laquelle il y a le lien entre l’économie et l’écologie date de 1906 par Nicholas Georgescu-Roegen dans une ouvrage.
L’ouvrage phare sur les problèmes liés à la croissance est le rapport de Dennis et Donella Meadows intitulé ‘les limites de la croissances’, rapport qui simule pour la premières fois les dégats écologiques d’une croissance infinie dans un monde aux ressources finies.
La 3e mention du terme décroissance vient de Bernard Charbonneau en 1974 où il fait une critique du développement exponentiel.
En 1976, Fred Hirsch publie ‘les limites sociales de la croissance’ où il conclue que l’argent et la croissance ne fait pas le bonheur.
Enfin en 1979, sort les traductions des ouvrages de Nicholas Georgescu-Roegen sous le titre de ‘Demain la décroissance’.
La naissance de la décroissance
Après 2 décennies de gestation, le magazine Silence publie un numéro spécial intitulé “Décroissance soutenable et conviviale” en 2002 et un article de Hervé Kempf du Monde intitulé “Sauver le monde par le décroissance soutenable”, terme qui vient en opposition au développement durable, promesse impossible à tenir.
Viendra ensuite un article de Serge Latouche qui apporte un angle nouveau, celui d’une décolonisation de l’imaginaire de la croissance, associant le décroissance à l’abandon de la croyance que plus est toujours synomyme de mieux.
Le nouveau projet de la décroissance vide a se débarrasser de la religion de la croissance et avec elle les sous-idéologie qui l’alimentent : économisme, néolibaralisme, extractivisme, utilitarisme, capitalisme, commercialisme, consumérisme et techno-scientisme.
Le premier livre sur la décroissance sort en septembre 2003 intilulé ‘ objectif décroissance : vers une société harmonieuse’.
Le terme se répand en France et au delà vers les domaines d’action : Colloque, manifestation puis stratégie de campagne pour les élections présidentielles de 2007 et les élections européennes de 2009.
En 2006 sort l’ouvrage de référence de Serge Latouche intitulé ‘Le pari de la décroissance’ ou il décrit la décroissance comme un cercle vertueux composé de 8 changements interdépendants.
La même année est créée la revue semestrielle Entropia, qui vise a donner les fondements théorique du concept. Elle publiera 16 volumes sur le sujet et impliquera 174 auteurs.
La décroissance aujourd’hui
A partir de 2008, la décroissance s’invite dans des conférences, dans la littérature scientifique, les ouvrages, revues, cours, groupes de travail et programme politique.
Il existe aujourd’hui près de 600 articles académiques en anglais sur la décroissance. Depuis 2020, une nouvelle revue (Degrowth Journal) se spécialiste sur la question.
Depuis 2011, il y a des conférences et des cours sur la décroissance organisés à Science Po.
On ne compte plus les ouvrages sur le sujet.
La décroissance est devenu aussi un vaste domaine d’action.
Une étude de février 2022 a montré que seulement 1% des experts travaillant à l’agence fédérale allemande pour l’environnement croient encore à la croissance verte.
En 2013, un laboratoire de recherche de Science Po publie un rapport intitulé “Une société post-croissante pour le 21e siècle”.
En 2017, une motion est déposée pour constituer une commission ‘Société post-croissante’ au sein du parti Europe Ecologie Les Verts.
Le GIEC commence à utiliser le terme dans le rapport du groupe 2 sur l’adaptation au changement climatique.
Depuis 2009, la formation politique Europe décroissance à participé à toutes les éléctions européennes.
En 2020, le président Irlandais annonce dans un discours que ‘la décroissance est la seule stratégie soutenable pour la survie de la planète’.
En 2021, Delphine Batho s’annonce comme la ‘candidate de la décroissance’ à la primaire de la présidentielle.
Quand on parle de décroissance aujourd’hui, il faut donc bien intégrer les 3 acceptations évolutives du concept : l’objection de croissance, la décroissance et enfin la post-croissance.
Un chemin de transition
Comment concrètement mettre l’économie en décroissance ?
Réduire la production et la consommation
Cela signifie faire rétrécir et ralentir l’économie.
Rétrécir, cela signifierait faire disparaitre les activités publicitaires, les services financiers, une grande part de l’économie de service serait démarchandisé. Par suppression des incitations, cela ferait baisser la consommation, et donc les extractions et les pollutions qui y sont liés.
Ralentir, s’apparenterait à la sobriété, une forme de modération (choix de limiter) contrairement à la frugalité qui est une forme de renoncement (choisir de ne plus faire quelquechose que l’on faisait avant).
Il faudrait engager des politiques de décroissance exactement de la même manière que l’on engage actuellement des politiques de croissance.
Le véritable défi de la décroissance est d’organiser ce grand ralentissement pour qu’il soit écologiquement soutenable, socialement juste et démocratiquement acceptable.
Décroissance signifie travailler plus lentement ou moins, ou un mix des deux.
Une baisse du temps de travail salarié ne signifie pas un baisse du travail, le temps sera dédié à d’autres activités productives et reproductives en dehors de la sphère marchande.
Concernant la consommation, on pourrait interdire la publicité dans les espaces public, en particulier les produit à haute intensité écologique ce qui naturellement fera baisser la demande pour ces produits.
Ces exemples font partie des 380 mesures concrètes de décroissance.
En sommes c’est la multitudes de mesures plus ou moins sélective qui permettra un réel impact sur l’économie, avec comme objectifs princiapux d’aléger l’empreinte écologique de maniére démocratique dans un ésprit de justice sociale et dans un soucis de bien-être.
Pour alléger l’empreinte écologique
La soutennabilité d’une économie est une histoire de proportion.
La règle fondamentale de toute économie écologique est que la vitesse économique de la consommation-rejet ne doit jamais dépasser la vitesse écologique de la régénération-assimilation.
En 2015, la France transgressait 6 des 7 limites planétaires : émissions de gaz à effet de serre, usage du phosphore et de l’azote, empreinte matérielle, empreinte écologique, usage des sols.
Comme pour un régime, la réduction ne doit pas tendre vers 0 mais vers un niveau aux plafonds écologiquement soutenables.
Cet effort sera différent selon l’ampleur du dépassement de chaque pays. (pas le même pour les USA que pour la Suède par exemple).
Cet effort sera sélectif et cibler en priorité les biens et services qui ont un fort impacts écologique (carbone mais aussi extraction de matériau, usage des sols, etc.).
Pour agir, on peut grouper par 3 grandes catégories : les leviers d’interdiction, de rationnement et de fiscalité.
Il serait possible de fermer les lignes aériennes nationales, limiter les vols, bannir la publicité pour les voyages en avions , interdire la vente de voitures a moteur thermique, abaisser la limitation de la vitesse.
Il serait possible de rationner l’usage des énergies fossiles, via un système de carte carbone, ou par quota.
Il serait possible d’augmenter le prix des activité que l’on souhaite décourager comme une taxe sur les billets d’avions, qui augmenterait à chaque vol supplémentaire, un système de bonus-malus sur le cout des voitures lourdes et polluantes, etc.
Cette tâche est plus facile qu’on ne le pense car 71% des émissions mondiales peuvent être rattachées à seulement 100 entreprises et 20 entreprises les plus polluantes causent 1/3 des ces émissions.
En 2019, seulement 20 entreprises sont responsables d’un peu plus de la moitié des déchets plastiques de la planète.
L’importance c’est la double action sur la production et la consommation.
Planifiée démocratiquement
Aujourd’hui le modèle des entreprises à but lucratif va à l’encontre d’un objectif de décroissance.
Cette propension de l’économie à croitre est intentionnellement planifiée. Au niveau mondial, ce sont les grandes entreprises qui décident quoi produire, avec l’accompagnement de l’Etat qui facilite ouvertement leur expansion et nous incite à la consommation (elle même partiellement planifiée par la publicité).
Pour pouvoir mettre en oeuvre une stratégie de décroissance il faudra nécessairement reprendre le contrôle des organisations qui aujourd’hui bloquent activement toute tentative de sobriété.
On pourrait imaginer un pôle public de l’énergie rassemblant EDF, Engie, Total et d’autres petits fournisseurs pour permettre la coordination d’une stratégie de sobriété de l’énergie.
Même chose pour un pôle stratégique du transport incluant la nationalisation de la SNCF, des autoroutes, des aéroports et des grandes compagnies aériennes et maritimes.
Un contrôle démocratique des grandes banques permettrait de suspendre le financement de toutes les entreprises qui développant de nouveaux projets d’extraction d’énergie fossiles.
Même chose pour l’industrie pharmaceutique, les entreprises de télécommunication et toutes les entreprises que l’on voudrait radicalement transformer à l’avenir, en particuliers les secteurs stratégiques.
Pour les autres entreprises, l’objectif devra être de devenir des coopératives, c’est à dire démocratiser leur mode de fonctionnement permettant des prises de décisions pour l’intérêt général.
Dans un esprit de justice sociale
La décroissance doit être écologiquement efficace mais aussi être juste, selon le principe des ‘responsabilités communes mais différenciées’, donc d’équité.
C’est une logique de contraction et de convergence : décroissance pour les privilégié et croissance pour ceux qui en ont le plus besoin.
Et dans un souci de bien-être
La façon la plus facile de faire baisser l’empreinte écologique tout en maintenant la qualité de vie est de renoncer aux produits les plus polluants qui contribuent peu au bien-être : réduire les vols en avions en commençant par les vols fréquents le weekends en permettant les vols humanitaires ou les réunions de familles.
Ce serait étendre l’accès à des services publics de qualité et gratuit : santé, éducation, transport en commun, gestion de l’eau, accès à internet, etc financés collectivement par des cotisations.
Les prix de l’immobilier ne pourraient dépasser un seuil maximum de prix, comme pour les médicaments, les assurances.
Une garantie de l’emploi permettrait d’éviter le chômage accidentel via un système de coopérative d’emploi.
Il faut prendre conscience que la plupart des activités les plus importantes pour notre bien-être ont une très faible empreinte écologique.
Un projet de société, vers une économie de la post-croissance
Une économie n’a pas vocation à décroitre jusqu’a disparaître complètement. La réduction n’est qu’une phase transitoire vers une économie stationnaire et pérenne.
Économie stationnaire
Une économie stationnaire post-croissance aurait un PIB stable avec cette double question fondamentale “de quoi avons-nous vraiment besoin pour être heureux ?” et “que pouvons-nous vraiment nous permettre de produire pour préserver l’habitabilité de notre planète ?”
Cela ne signifie pas la fin de l’innovation et du progrès. En économie stationnaire, les gains de productivité sont utilisés pour réduire le temps de travail et rendre les conditions plus agréables.
Pour cela il faut se libérer des impératifs de la croissance émis par trois groupes d’acteurs principaux : les gouvernements, les entreprises et les consommateurs et renouer la relation avec le vivant en donnant des droits à la nature comme nous nous sommes donné des droits à nous même.
Où les décisions sont prises ensemble
Pour savoir ce dont les gens ont besoin, il faut qu’ils puissent s’exprimer : allier une démocratie directe, délibérative et participative de proximité à une démocratie représentative à de plus hautes niveaux.
A l’échelle locale, des tables de quartier pour des projets entre voisins.
A l’échelle d’une commune, des budgets participatifs pour décider et repartir le budget municipal.
A l’échelle des entreprises, des conseils de cogestion pour convier les acteurs du territoire dans le processus de décision sur les choix et les prix.
A l’échelle du pays, des conventions citoyennes.
A l’échelle internationale, des assemblées transnationales.
Pour revenir aux entreprises, on peut imaginer que celles-ci soient obligée de définir une mission de production claire qui justifie aux yeux du public en quoi consiste son activité et en quoi celle-ci est utile à la satisfaction des besoins, sous le contrôle d’une comité en charge de vérifier l’adéquation de l’activité avec sa mission.
Pour exister, une entreprise doit avoir une mission qui répond à la double sélectivité évoqué précédemment.
Elle suivrait des indicateurs de prospérité à l’équilibre entre au moins 3 grandes familles d’objectifs : la soutenabilité, la convivialité et la productivité. Dans cet ordre. La productivité n’arrivant qu’en dernière position.
Décider ensemble veut aussi dire décider ensemble comment financer des nouveaux projets. Il faudra que les entreprises puissent se financier auprès d’acteurs qui n’exigent pas de retour financiers, via des coopératives bancaires à but non lucratif, des fonds socialisés d’investissement qui fonctionnerait sur le même principe que la sécurité sociale.
Bref il faudra que les décisions d’extraction, de production, l’allocation, de consommation et d’élimination soient prises ensemble.
Où les richesses sont équitablement partagées
Tout le monde ne peut pas avoir plus tout le temps et tout le monde devrait pouvoir satisfaire ses besoins les plus fondamentaux. Il faut donc trouver des protocoles régissant l’allocation des choses entre les gens.
Ce partage intervient à trois niveaux : en amont de la production (prédistribution de l’héritage), pendant le processus de production (distribution de la valeur ajoutée) et après coup (redistribution des richesses accumulées).
On pourrait élargir la logique de sécurité sociale à une sécurité économique. Par exemple avec un héritage minimum garanti, comme une dotation universelle que chaque personne recevrait à l’age de 25 ans comme le propose Thomas Piketty financé par l’impôt sur la propriété privée, progressif.
Les entreprises à but lucratif seront amenés à disparaitre, des coopératives seront organisées selon le principe de la lucrativité limitée et de la propriété partagée. Signifiant que la valeur ajoutée d’une entreprise sera équitablement partagée entre les différentes parties prenantes internes ET externes.
Enfin concernant la redistribution, une taxation des revenus progressive en fonction des revenu. Les revenus les plus élevés paieront jusqu’à 90% d’impôts sur les revenus dépassant plusieurs milliers de fois le revenu moyen.
Cela pourra financer le revenu minimum garanti fixé au seuil de pauvreté, reçu automatiquement par toute personne vivant en dessous de ce seuil.
Afin de pouvoir prospérer sans croissance
L’objectif central de la post-croissance est la capacité d’une économie à pouvoir atteindre un haut niveau de qualité de vie sans croissance.
Pour cela il faut de nouveaux indicateurs pour mesurer cette prospérité.
On peut prendre exemple sur la Nouvelle-Zélande qui a produit un tableau de bord de 65 indicateurs économiques, sociaux et environnementaux pour remplacer le PIB.
Controverses, 12 critiques de la décroissance
Repoussoir
Une fois compris que la décroissance n’est pas une récession, mais plutôt une transition vers une économie démocratique, soutenable, juste et joyeuse, à quoi bon avoir peur du mot ?
Il faut produire et consommer moins, tout en s’organisant pour que ce grand ralentissement se fasse sans casse sociale.
Douloureuse
Même si cette cure de désintoxication matérialiste est désagréable, nous n’avons pas le choix.
Retarder l’action climatique par peur de déprimer une minorité de super-riches paraît indécent dans un monde où la pauvreté subsiste.
Inefficace
Réduire la production ne veut pas dire arrêter de verdir. On peut allier le moins et le mieux, combiner sobriété et éco-efficacité. Eviter tout ce qu’il est possible de ne plus consommer, substituer les produits les moins polluants à ceux qui polluent d’avantage et concentrer les efforts d’éco-innovations pour améliorer tout ce qu’on ne peut pas éviter ni substituer.
Appauvrissante
La décroissance ne devrait s’appliquer qu’à ceux qui ont déjà assez, en commençant par les plus riches. On ne demande pas à ceux qui ont du mal à se nourrir de se mettre au régime.
Confondre sobriété et pauvreté est intellectuellement malhonnête. Une transition décroissante viendrait détruire la richesse financière pour la transformer en richesse sociale et écologique.
Egoiste
On a eu tord de penser que notre croissance alimentait un cercle vertueux de mondialisation bienfaisante. C’est tout le contraire. Les riches s’enrichissent et les pauvre s’appauvrissent.
La décroissance est une stratégie pour inverser la tendance, mettre en oeuvre une désaccumulation par la réparation. Une partie de la richesse financière dont les riches se débarrasseront sera données aux zones pauvres.
Austéritaire
L’austérité est une stratégie néolibérale qui consiste à contraindre les dépenses publiques et à baisser certains impôts pour relancer la croissance économique.
La décroissance viendra t-elle contracter les budgets publics ? mécaniquement oui si on conserve son mode de financement basé sur le PIB.
Le mode de financement de l’état est donc à revoir.
Capitaliste
Depuis l’origine, le courant de pensée décroissant est anti-capitaliste.
Si l’on veut sortir de la croissance, il faudra donc nécessairement sortir du capitalisme et donc réduire l’importance sociale des institutions qui la compose : le salariat, les marchandises, les marchés, les entreprises à but lucratif.
Anti-innovation
Dans un système économique où l’on invite pour s’enrichir, les problèmes auxquels répond l’innovation sont principalement ceux des plus privilégiés et rarement les plus urgents.
La décroissance ne va pas interdire l’innovation mais en changer totalement le contenu.
Anti-entreprise
La décroissance n’est pas anti-entreprise mais antilucrativité.
Il faut se débarrasser du cliché capitaliste comme quoi toutes les entreprises chercheraient à croitre comme des plantes. Ce n’est pas le cas des coopératives sociale et solidaires qui définissent leurs performances au delà des profils.
Vu que les grands groupes sont responsables de la plupart des activités néfastes, la décroissance est avant toute chose la réduction de l’importance qu’ont prise ces mastodontes dans la vie économique.
Contre nature
C’est mal connaitre l’histoire des société humaines que de penser que nous avons toujours adulé l’argent et poursuivi son accumulation.
L’idée même de faire croître indéfiniment le bonheur par l’accumulation ne se vérifie pas dans les études. Le bonheur est une histoire de qualité plus que de quantité.
Les comportements qui sont aujourd’hui la cause de notre malédiction sont déterminés par les conventions sociales, rien de plus.
Inacceptable
Toutes les études portant sur le support de la décroissance par la population démontrent que la décroissance a le vent en poupe, que le concept est vu favorablement par la population dans son ensemble.
Totalitaire
C’est mal comprendre le capitalisme que de la qualifier de démocratique. La minorité de ceux qui possédant les moyens de production décide de quoi produire sans consulter personne. Ce n’est pas un mode de gestion démocratique mais ploutocratique : la planification de l’économie par les riches.
La décroissance nécessite la mobilisation courageuse de toute la force de la société. Il faut descendre en dessous des plafonds écologiques.
En dessous de ces seuils, nous resterons libres d’utiliser les ressources comme nous le voulons.
Conclusion
La plupart des économistes croient dur comme fer à un futur verdissement du PIB et de la croissance malgré plusieurs décennies d’échecs.
La croissance détruit la nature, nous épuise et ne vient même pas honorer les promesses d’éradication de la pauvreté ou d’amélioration de la qualité de vie.
Il faut dire adieu à la croissance, choisir de sortir et démystifier la croissance. Ralentir pour survivre mais aussi pour bien vivre.
Le véritable défi de ce début de siècle est d’inventer un système économique qui assure ‘le bien être pour tous dans les limites de la planète’. Cette autre économie, nous ne sommes pas les premiers à la vouloir. Elle est expérimentée à divers endroits de la planète, utilisant des concepts et des modèles qui émergent et qui abondent : économie participaliste, économie du bien-être, économie du donut, économie permacirculaire, démocratie économique, socialisme participatif, permaentreprises contributives, societé rationnelles, etc.
Il ne faut pas hésiter à prendre les devants, comme l’ont fait les diplômés d’Agro Paris Tech en désertant les emplois destructeurs, comme ‘la grande démission’ américaine ou le mouvement ‘anti-productivité’.
Nous ne donneront pas notre temps, notre énergie et nos compétences pour ce système. Nous ne collaborerons pas.
Déserter ce n’est pas abandonner la société dans son ensemble, mais seulement un capitalisme vide de sens et à bout de souffle.
Ressources extérieures sur le livre
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/interception/interception-du-dimanche-06-octobre-2024-3459203
https://podtail.com/podcast/l-octet-vert-par-tristan-nitot/octet-vert-s3e02-timothee-parrique-sur-la-decroiss/